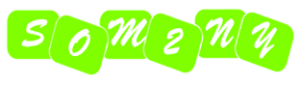Karibu ! Bienvenue à Zanzibar, ce petit archipel posé sous l’équateur exactement, dans l’Océan Indien, à quelques dizaines de kilomètres de ferry de Dar-es-Salaam, la capitale économique de la Tanzanie. Lagons turquoises, sable blanc, tortues géantes, poisson grillé, fragrances de musc dans l’air du soir, flamboyants et noix de coco… Autant de clichés dont raffolent les tours operators, convoquant dans leurs brochures le fantasme d’une insularité paradisiaque, sensuelle et intacte pour occulter une réalité très instable qui résume à elle seule l’ornière post-coloniale. Must do pour parfaire l’expérience dans ce décor en trompe-l’œil : un concert de taarab sur le rooftop étoilé d’un hôtel style persan, combo lune et nuit d’orient.
« Écouter un bon orchestre de taarab à Zanzibar, c’est comme se laisser glisser sur l’Océan Indien à bord d’une boutre de pêcheurs poussée par les vents de mousson dans le soleil couchant… C’est l’extase, une sensation unique » souffle Yusuf Mahmoud, fondateur du célèbre festival Sauti Za Busara (« les sons de la sagesse »), qui défend activement la scène taarab zanzibarie depuis la création de l’évènement en 2003. Programmée cette année, la chanteuse Siti Amina va plus loin : « Le taarab a une dimension spirituelle pour moi. Portée par sa sophistication mélodique, sa poésie, je vole au-dessus de tout : quand je chante, j’ai l’impression d’être au paradis ! »
Dérivé du mot arabe tariba — « être touché d’extase face à la beauté » selon l’ethnomusicologue Gilbert Rouget dans La Musique et la Transe — le taarab est LA musique traditionnelle de Zanzibar. Il y en a d’autres, endémiques, le ngoma, le kidumbak, le béni, le msondo, mais de toutes, le taarab est la plus connue parce qu’il s’étend, de l’Égypte jusqu’à Mayotte, sur toute la côte swahilie de l’Océan Indien. Par essence, le taarab est syncrétique et composite. À l’image de l’archipel zanzibari, véritable carrefour migratoire, commercial et culturel influencé au cours des siècles par les sultans arabes, les conquérants portugais, les marchands d’esclaves, les commerçants indiens, les colons britanniques, la vitalité continentale et le tourisme international. Ainsi trouve-t-on traditionnellement dans ses orchestrations nobles et complexes des instruments aussi divers que le oud, le qanûn, le violon, la contrebasse, l’accordéon, des tablas, riqq, daf et percussions locales.

À Zanzibar, le taarab demeure une institution, grâce aux grands noms qui ont nourri sa réputation bien au-delà de la seule Afrique de l’Est, à des passeurs passionnés et à une politique touristique qui entretient son mythe. Mais que se joue-t-il pour le taarab zanzibari au verso de la carte postale ? Car derrière le mythe, il y a une histoire et entre ses lignes, la vie d’une musique où se croisent aujourd’hui des questions politiques et sociales, la survie d’une culture et d’une identité mais aussi le rôle que les femmes, figures clés du taarab, continuent d’y jouer. Leurs voix résonnent encore dans le présent de l’archipel et les consciences de la jeune génération qui ne jure, semble-t-il, que par les musiques urbaines.
Le taarab aux Grammy Awards
À l’ombre des grands acacias du Forodhani Garden, Brain Boy se fait désirer. À quelques jours de son premier concert sur la scène du festival Sauti Za Busara, tremplin de choix pour les artistes de la région, la nouvelle recrue du « zenji flavor » a la pression. Si Brain Boy n’est pas là ce matin, c’est parce qu’il est encore en studio en train de répéter avec son groupe. Alors c’est parti : direction Stone Town Records, son label, son QG, sa « deuxième maison. »
Il faut pour cela triompher d’abord du dédale de ruelles de la mythique ville de pierre, le quartier historique de Zanzibar City, un trésor d’architecture classé à l’Unesco, « une médina en terre swahilie, des palais arabes sous les tropiques, un éclat des Indes en Afrique » écrit Jean-Blaise Besençon dans Zanzibar (ed. Favre, 2005). S’engage un slalom entre une meute de touristes à mollets blancs et des nuées de vendeurs de souvenirs, de perles et d’épices qui s’entassent au soleil sur les baraza, ces bancs de béton qui longent les échoppes. Midi ! indiquent les cloches de la Cathédrale Anglicane, construite en lieu et place d’un effroyable marché aux esclaves après l’abolition de la traite d’êtres humains à Zanzibar en 1873. Allâhou Akbar ! répondent les muezzins du haut de leur minaret. Il fait chaud. Kiponda Street. Enfin c’est là, à gauche. Porte en fer, escalier, studio A, studio B.

Clavier, basse, batterie, oud, violon et qanûn font trembler les murs tagués de ce petit appartement transformé en haut-lieu du zenji flavor, un mouvement hip-hop né dans les années 90 à Zanzibar qui sample abondamment le taarab dans un geste créatif et identitaire — celui du hip-hop afro-américain quand il emprunte ses plus beaux gimmicks à la Great Black Music. Les pionniers Kolpara, Ali Haji ou encore DJ Saleh ont ouvert la voie à d’autres, Zenji Boy notamment, premier artiste signé chez Stone Town Records qui depuis organise régulièrement des compétitions de rue pour y dénicher ses futurs talents, le meilleur MC se voyant offrir l’opportunité d’intégrer le label. Lorsque Brain Boy apparaît, c’est en traînant les tongs, vêtu d’un maillot officiel de l’équipe de football de l’archipel, et à son nom s’il vous plaît.
« Mon rêve, c’est de voir le taarab gagner un Grammy Award ! » sourit Hamid Sabur Soud, alias Brain Boy qui, à 28 ans, est déjà lauréat d’un Zanzibar Youth Award pour The Return of Zenji Flavour, un premier EP sorti en 2022. Le taarab, Brain Boy le tient de sa mère, une mélomane qui lui met dans la tête ses premiers airs de qanûn. Et puis de toute manière, difficile d’y échapper : mariages, élections, radio ou télévision, le taarab est l’invité de marque de toutes les grandes occasions. « Le taarab, c’est la musique naturelle de Zanzibar, sa véritable saveur » affirme Brain Boy. « Ici, en Tanzanie, en Afrique, la jeunesse ne jure que par le rnb, le singeli, l’afrobeats. Moi je n’en démords pas : le taarab, c’est notre musique traditionnelle, notre identité, je suis né ici : donc faire du zenji flava aujourd’hui, c’est dire au monde qui je suis. Mais pour pouvoir chanter à la façon des grands maîtres du taarab, comme le regretté Makamé Faki, mon favori, j’ai dû beaucoup travailler et pour cela, j’ai suivi des cours à la Dhow Countries Music Academy avec Siti Amina. Car quand j’ai commencé, les gens se moquaient de moi, ils disaient que je chantais mal et que ma voix était moche. Or, le secret du taarab, c’est la voix, c’est elle qui vous procure toutes ces émotions. » Comme pour témoigner de ses progrès, Brain Boy se met à chanter.
Aujourd’hui, Brain Boy se produit régulièrement à Zanzibar, et parfois, dans des événements officiels à la demande du gouvernement local. « C’est intéressant car cela me permet de rencontrer des gens, de jouer dans l’espace public et, parfois, de me faire un peu d’argent. C’est du gagnant-gagnant : je soutiens le gouvernement qui me soutient en retour » explique le chanteur qui n’est pas le seul ni le premier à saisir, de gré ou de force, la main tendue du monde politique. Intimement lié à l’histoire de l’archipel, le taarab a-t-il encore un rôle à jouer sur l’échiquier local ?

Entre poétique et politique
Sous domination arabe puis britannique, Zanzibar proclame son indépendance le 10 décembre 1963. S’ensuit une révolution l’année suivante, soutenue en musique par le Culture Musical Club notamment, un ensemble de taarab désormais légendaire qui, tout jeune à l’époque, voit dans le parti révolutionnaire Afro Shirazi d’Amani Karume l’espoir de lendemains plus justes… Un rêve brisé par deux longues décennies de sombre dictature — « l’horreur absolue » relate l’auteur Adam Shafi Adam au chapitre des geôles de Zanzibar dans Haini, le traître — et une gouvernance locale confisquée par l’État tanzanien au profit de la Tanganyika African National Union dont les louanges seront chantées par d’autres voix du taarab. À partir du mitan des années 80, Zanzibar assiste au retour d’un semblant de démocratie et le taarab continue d’accompagner « les mues et les remous insulaires » pour citer la géographe Nathalie Bernardie-Tahir dans L’Autre Zanzibar, géographie d’une contre-insularité (ed. Karthala, 2007).
Mais depuis, d’élections locales truquées en répression systématique des voix d’opposition, l’archipel peine aujourd’hui encore à (re)trouver une stabilité politique, de même que la confiance de sa population. Alors, pour faciliter la médiation, la sphère politique fait appel aux artistes en vue, en particulier pendant les périodes d’élections. Celle du président Hussein Ali Mwinyi en 2020 par exemple qui, pour s’attirer les votes de la jeunesse zanzibarie, invitait Brain Boy à se produire avec son groupe pendant sa campagne. « Récemment encore, nous avons joué pour l’inauguration du nouvel hôpital de Stone Town » ajoute ce dernier.
« C’est cool et je joue le jeu, car mon président fait de bonnes choses pour Zanzibar. Mais je dois avouer que je suis aussi extrêmement prudent. D’abord parce qu’ici, les gens sont dégoûtés de la politique et moi c’est pareil je n’aime pas ça. Trop de compétition, trop de déceptions. Et puis si tes fans te voient soutenir le « mauvais » parti, ils ont vite fait de te lâcher quand le vent tourne ou de penser que tu es un opportuniste, un politicien plutôt qu’un bon musicien. » Alors Brain Boy chante l’amour, l’épine dorsale poétique du taarab traditionnel dont la lugha ya majazi, la langue imagée, permet aussi de crypter la critique, sociale ou politique. L’année prochaine, Brain Boy sortira un premier album dans lequel il dit vouloir déborder la question romantique pour parler des « problèmes » de son pays. Notamment des « beach boys », ces jeunes hommes qui « au lieu de croire en eux » arpentent les plages de l’archipel pour vendre des bricoles, des excursions et le plus souvent du love à de jeunes touristes occidentales — lesquelles, une fois sous le charme, les aident à améliorer leur train de vie ou à lancer un business. Le sens des affaires, Brain Boy l’a aussi ceci dit. Avant d’aller faire des photos, le chanteur ouvre Cubase sur l’ordinateur du studio : en avant-première, son prochain tube… afrobeats. Aïe ! La tentation. Mais tout le monde y cède, même les tuk-tuks de Stone Town, qui diffusent les derniers hits en boucle sur des enceintes accidentées par les cahots de la route.
Conquérant, looké athlète, Brain Boy voit loin, au-delà de Sauti Za Busara déjà. En ligne de mire : les Zanzibar International Music Awards, un concours organisé par l’Emerson’s Zanzibar Foundation, pendant philanthropique d’une chaîne d’hôtels qui compte deux établissements et plusieurs restaurants rien qu’à Stone Town.

The DHOW must go on
« Si vous allez écouter du taarab dans un hôtel à Zanzibar, vous pourrez demander à n’importe quel musicien où il a étudié, il vous répondra : à la DCMA » lance fièrement Halda Alkanaan, la directrice de la seule école de musique de l’archipel. À quelques minutes à pied du cœur bouillant de Stone Town, la Dhow Countries Music Academy promet un havre de paix protégé du trafic de Vuga Road par une foule de tamariniers piquetés d’oiseaux. C’est calme. Des chats maigres siestent sous les roues de scooters décatis. Par les fenêtres et les portes toujours ouvertes du vieux bâtiment blanc s’envolent des colliers de mélodies jouées au violon et le chœur dissonant d’instruments qu’on accorde. À l’entrée, il faut signer le registre des visiteurs et ce soir, ils seront nombreux pour assister au concert du Culture Musical Club, pilier historique du taarab fondé à la fin des années 50 et programmé chaque année en ouverture du festival Sauti Za Busara.
Pour l’heure, des grappes d’élèves pratiquent leur instrument dans les couloirs avant leur prochain cours, comme Frank, 25 ans, qui fait ses gammes sur son violon. Frank est tanzanien, il vient du continent et comme lui, nombreux sont les étudiants à venir de loin pour étudier tout spécialement à la DCMA. Fondée en 2001, l’école est en réalité une ONG financée essentiellement par des mécènes tels que les Ambassades de France et d’Allemagne en Tanzanie, le Rotary Club de Zanzibar et deux sociétés de télécommunication locales. Halda Alkanaan est la première personne originaire de Zanzibar à diriger la DCMA. Avant elle, ce sont des étrangers, des Européens surtout, qui ont occupé le poste. « En ce moment, nous avons trente étudiants, le plus jeune a sept ans et la plupart dépendent de bourses. Mais nous devons nous battre pour continuer à exister car nous souffrons de graves difficultés financières » objecte-t-elle, front inquiet. « Le gouvernement ne nous soutient pas. Pourtant, l’impact de l’académie est énorme ici à Zanzibar et au-delà. Nous sommes les seuls à travailler à la préservation, la transmission et la promotion des musiques traditionnelles de la région… Béni, ngoma, kidumbak, taarab : tout s’apprend chez nous ! Nous sommes aussi les seuls à œuvrer à la notation du répertoire taarab sur partitions : grâce à nous, n’importe quel musicien capable de lire une partition peut jouer du taarab. Sans parler du nombre de jeunes qui parviennent à gagner leur vie grâce à la musique. » Avec un taux de chômage des jeunes qui dépasse les 13% en Tanzanie et les 17% à Zanzibar (chiffres OIT, 2014), la DCMA a de quoi faire et motive ses troupes avec ce mantra affiché dans chaque salle de classe : « music for education, music for employment, music for joyment » (c’est-à-dire la musique pour l’éducation, l’emploi, la joie).
Au quotidien, Halda Alkanaan peut compter sur une petite équipe de professeurs passionnés qui, pour la plupart, ont d’abord été élèves à la DCMA. C’est le cas de Tryphon Evarist, trentenaire à l’incurable chapeau melon qui enseigne aujourd’hui l’accordéon, la théorie musicale, ainsi que les rudiments du qanûn et de la clarinette. Certains mois, ses collègues et lui ne touchent pas de salaire mais il en faut plus pour détourner de son sacerdoce ce pédagogue hyperactif. « Le plus grand défi que le taarab devra relever dans les prochaines années, c’est le manque de nouveaux compositeurs » analyse le musicien qui vient de sortir « Nitakuoa » (Je t’épouserai), un titre en swahili composé selon les canons du taarab traditionnel. « Si personne ne renouvelle son répertoire, le taarab va s’appauvrir, se scléroser. Sans la DCMA, le taarab serait en danger en mort mais tant qu’elle est là, je nourris l’espoir qu’elle génère les compositeurs de demain. » Quant à ceux d’hier, leur histoire se raconte sur les murs de l’école qui prend soin d’entretenir la mémoire du taarab.
Le taarab est introduit à Zanzibar par le peuple omanais qui régit l’archipel jusqu’à la fin du 19e siècle. Luxe et volupté, le sultan Sayyid Barghach trouve beaucoup de joie dans le divertissement et a coutume d’inviter des musiciens égyptiens chez lui, dans son palais sur le front de mer près du Vieux Fort. Parce qu’il n’est jamais rassasié de leurs mélismes raffinés et savants, le sultan envoie un de ses hommes, Mohammed Ibrahim, étudier au Caire afin qu’il se perfectionne dans l’art du violon et des percussions. À son retour, un petit groupe voit le jour et dès lors, des happy few se pressent à la cour du sultan pour écouter les mélopées d’amour du taarab qui, à l’époque, se chante et s’enseigne exclusivement en arabe et entre hommes, restant donc peu accessible au commun de la population locale. Avec la fin du sultanat d’Oman à Zanzibar en 1890 et l’assise du protectorat britannique, des choses changent. D’abord, le taarab quitte les salons du palais pour ceux, plus populaires, de la ville où se produit dès 1905 le premier groupe de taarab zanzibari, l’Ikhwani Safaa Musical Club, qui existe encore aujourd’hui. Mais c’est au féminin que s’écrit surtout la grande révolution du taarab à Zanzibar et sa pionnière frondeuse s’appelle Siti Binti Saad. « Siti Binti Saad a changé le cours de l’histoire, sa contribution est énorme pour le taarab » rappelle le professeur Tryphon, en désignant le portrait de « la mère du taarab » qui veille à l’encre bleue sur la petite cour de l’école.
La mater du taarab
Icône absolue pour avoir été la première à oser transgresser l’interdit fait aux femmes de chanter du taarab, Siti Binti Saad est aussi la première artiste du genre à enregistrer son répertoire, à Bombay, en Inde, en 1928, dans les studios de la British Gramophone Company — à la demande expresse de la maison de disques. Très populaire en Afrique de l’Est où elle tourne déjà avec un orchestre, Siti Binti Saad grave en quelques mois près de deux cents titres : les ventes sont au rendez-vous et même la diva égyptienne Oum Kalthoum fait le déplacement à Bombay pour la rencontrer ! Un succès loin d’être évident pour Siti Binti Saad née Mtumwa, c’est-à-dire « la servante », de parents esclaves dans les plantations d’épices en 1880 dans le village de Fumba. Mais la jeune femme refuse son destin enchaîné à la misère et adopte la particule « siti » qui fait d’elle une lady. Grâce à sa voix et à son esprit libre, la chanteuse s’invite dès 1920 dans les fines soirées de l’élite zanzibarie à Stone Town. Portée par un désir d’émancipation des dominations coloniales, musicales y compris, c’est là qu’elle engage petit à petit l’africanisation du taarab en chantant en swahili et en incorporant des rythmiques locales au pupitre des percussions. En somme, elle ancre le genre.
Dans ses chansons, Siti Binti Saad use d’une poésie tressée de réalisme, d’humour et d’improvisation pour critiquer la présence britannique, la corruption des institutions, les conditions de vie de travailleurs, le manque d’accès à l’éducation pour les femmes. Et quand elle chante l’amour et la vie quotidienne, Siti Binti Saad dénonce aussi les abus du patriarcat, allant même jusqu’à se moquer des performances des hommes sous les draps. « Le taarab a toujours une fonction critique à Zanzibar aujourd’hui, il agit comme une sorte de régulateur social » explique encore le professeur Tryphon. « En chansons, le taarab permet de régler ses comptes avec un voisin, faire une déclaration d’amour ou dépeindre les difficultés de la vie quotidienne tout en respectant le cadre des conventions sociales. Il aide à pacifier les liens dans une communauté en désamorçant les choses avec humour. Néanmoins, il faut bien constater un appauvrissement de la langue poétique du taarab : résultat, la critique étant moins bien formulée, elle est aussi moins constructive qu’avant. »
Critique, Siti Binti Saad l’est au point d’exposer sa colère contre l’injustice coloniale dans « Kijiti », un chanson des années 20 qui raconte la relaxe du violeur et assassin d’une jeune fille à Zanzibar — alors que celles qui ont dénoncé son crime sont incarcérées. Féministe, anticolonialiste, la mater du taarab a transmis son répertoire et son âme rebelle à sa protégée Bi Kidude qui, après elle, vivra aussi en insoumise. Lorsqu’elle s’éteint en 1950, Siti Binti Saad laisse en fait une loupiote allumée pour les suivantes. « De plus en plus de filles viennent étudier la musique chez nous, elles sont neuf cette année » se réjouit Halda Alkanaan. Parmi elles, Thureiya, 24 ans, chewing-gum, jeans, talons, voile, lunettes de soleil posées dessus. À la DCMA, la jeune femme étudie le chant taarab contre l’avis de sa famille. « C’est difficile de faire de la musique et de se construire en tant qu’artiste quand vos proches jugent que pour une femme, ce n’est pas acceptable, pas moral » regrette-t-elle. « Mais des femmes comme Siti Binti Saad et Bi Kidude nous ont prouvé que le taarab est un puissant vecteur d’émancipation et moi j’aime trop ça ! Donc j’avance en conquérante et je travaille toujours plus car la magie du taarab, c’est qu’il accepte toutes les voix. »

Polé Polé : doucement mais sûrement
« La société zanzibarie s’est construite sur l’immigration : le métissage, l’hybridité, sont donc des piliers de notre identité » pose Siti Amina, au lendemain de son live sur la grande scène du festival Sauti Za Busara, qui invite chaque année son public de privilégiés à célébrer la diversité des musiques d’Afrique à grands renforts de fusions originales et de têtes d’affiches fédératrices. Au programme de cette 21e édition : Zoë Modiga, Madé Kuti, le jazz spirituel du collectif sud-africain The Brother Moves On, les harangues à la James Brown du harpiste ougandais Aliddeki Brian, le rnb éthéré de la réunionnaise Sibu Manaï, le duo est-ouest Afropentatonism entre gammes éthiopiennes et blues du désert, la star du singeli tanzanien Sholo Mwamba ou encore le reggae massaï des Warriors From The East.
À deux pas de l’enceinte du Vieux Fort où ont lieu la plupart des concerts, l’Hifadhi Zanzibar Majestic Theatre flotte hors du temps. Dans son patio rayé de mosaïques ouvragées, le gardien du temple joue au violon un classique du maqâm arabo-andalou tandis qu’à l’extérieur des femmes font frire des mandazi, des beignets à la cardamome, sous les branches d’un vieil oranger que berce une brise marine. « Hifadhi signifie préserver en swahili » explique Siti Amina en ajustant le foulard blanc qui encadre son visage. « J’ai choisi ce lieu car il s’agit de l’un des derniers spots de musique live à Stone Town et l’un des rares bâtiments historiques de la ville à ne pas encore avoir été transformé en hôtel depuis la mise en tourisme de l’archipel à la fin des années 80. J’aime venir ici, c’est paisible, je m’y sens bien. » Hifadhi, une oasis à l’écart du tumulte et des sollicitations, nombreuses pour la présidente de l’association Live Music in Zanzibar, membre de la Central Art Federation of Zanzibar, ambassadrice du tourisme, et défenseuse des droits des femmes auprès de diverses associations. Elle est aussi professeure de chant, et leadeuse du groupe Siti & The Band, formé à la fin de ses études à la DCMA en 2015.
Avec Fusing The Roots, un premier album sorti en 2018, Siti & The Band présente en huit titres un taarab aux fondations traditionnelles enrichi d’éclats jazz, de grooves funk ou reggae, dans un geste de rénovation par la fusion d’un genre qui « s’il est vivant, doit forcément évoluer » selon la chanteuse. « À Zanzibar, nous dépendons du tourisme aujourd’hui et c’est complexe pour les artistes qui jouent du taarab. Les touristes veulent être divertis et s’amuser sur des rythmes dansants mais en même temps, ils sont en quête d’authenticité, d’une forme de pureté traditionnelle — fantasmée bien sûr. Dans les hôtels, les musiciens sont parfois obligés de jouer des reprises façon taarab pour satisfaire les clients, du Céline Dion ou que sais-je ! Avec Siti & The Band, nous tâchons d’être à l’équilibre, de trouver le bon dosage pour exister au présent sans compromettre notre héritage. De la même manière que Bi Kidude a repris en son temps des morceaux de Siti Binti Saad, à notre tour nous reprenons des chansons de Bi Kidude pour les propulser vers de nouveaux lendemains. » Vénérable Bi Kidude, « la petite chose » en swahili, qui depuis sa mort en 2013, à plus de cent-deux ans, demeure la voix la plus connue de l’archipel.
C’est en fuyant la misère et un mariage forcé qu’à l’adolescence Bi Kidude rencontre Siti Binti Saad, qui la prend sous son aile pour lui transmettre sa science du taarab. À son tour, Bi Kidude innove, troquant le voile de son aînée contre des clopes qu’elle grille sur scène entre deux tours de chant. Gouailleuse invétérée à l’humour cru à la voix rauque, Bi Kidude revendique son goût pour le Konyaki, la fête, la liberté — la légende raconte que l’une de ses premières mutineries fut de s’enfuir à dix ans de l’école coranique. Si la musicienne sait se soigner, elle s’occupe des autres aussi : guérisseuse spécialiste des plantes, Bi Kidude est par ailleurs très demandée pour sa maîtrise du msondo, un chant rituel d’initiation pour les jeunes filles dont la cérémonie et les danses unyago marquent le passage à l’âge adulte.
Après des débuts aux côtés de Siti Binti Saad dont elle prolonge et augmente le répertoire, Bi Kidude tourne dans le monde entier avec divers orchestres, le Culture Musical Club ou les Twinkling Stars qui l’accompagnent lors d’un concert d’anthologie au Théâtre de la Ville à Paris en octobre 1990. La réputation internationale de la reine du taarab est telle qu’elle attire du monde dans l’archipel, notamment Andy Jones qui lui consacre, en 2006, le documentaire As Old As My Tongue: The Myth and Life of Bi Kidude. À Ng’ambo où elle réside dans une case de parpaings, le documentariste britannique filme alors une dame ridée comme une vieille pomme qui lorsqu’elle chante s’anime d’une énergie de lionne.
Comme Siti Binti Saad et Bi Kidude avant elle, Siti Amina déserte mariage et violences conjugales pour se consacrer à la musique. Et, comme elles, Siti Amina chante les femmes « car il faut dire la vérité, c’est le silence qui nous tue. » À ces mots, elle saisit son oud et commence à jouer une fois passé l’appel de salat asr, la prière de l’après-midi, qui dépose sa rumeur céleste sur les murs d’Hifadhi. Pendant trois minutes, l’acoustique des lieux sublime son interprétation nue d’ « Uchungu wa mwana », un titre de Siti Binti Saad qui traite du défi gigantesque de la maternité repris, près d’un siècle plus tard, en version uptempo par Siti & The Band en featuring avec G Nako, une star de l’afrobeats suivie par des millions de jeunes tanzaniens.

« Siti Binti Saad et Bi Kidude sont évidemment de grandes inspirations pour moi. Comme elles, j’ai dû me battre pour être libre et que la société m’accepte en tant que musicienne. Voilà pourquoi j’ai commencé à enseigner : la musique a changé ma vie, elle m’a libéré, alors c’est à mon tour de transmettre aujourd’hui. De toute manière, il y a trop peu de musiciennes professionnelles à Zanzibar. À ma mesure, je tâche d’y remédier, en encourageant un maximum de femmes à se lancer. C’est formidable que le taarab existe encore dans une société comme la nôtre et pour les femmes d’ici, il offre un espace d’expression sans pareil. Car de nos jours, les chanteurs sont des chanteuses la plupart du temps. Traditionnellement, dans les concerts de taarab, les femmes s’assoient à l’arrière, cachées derrière les musiciens et quand c’est le moment, elles se lèvent et passent devant pour chanter. C’est vraiment une chance pour les femmes de Zanzibar, elles peuvent s’emparer de l’espace et s’exprimer à voix haute, ça, c’est très bien. Mais aujourd’hui, la DCMA forme aussi de plus en plus de femmes aux instruments du taarab. Cela leur permet d’être sur le devant de la scène pendant tout un concert et de pouvoir prouver leur virtuosité au oud, au qanûn, au violon, aux percussions : c’est là aussi que se joue l’égalité.
Les choses progressent polé polé, doucement mais sûrement, il y a plus en plus de femmes instrumentistes et c’est génial. Cependant, la majorité des arrangeurs, compositeurs et paroliers reste des hommes, donc j’espère qu’à l’avenir, le taarab pourra compter sur une nouvelle garde de compositrices. »
La théorie du baggy
Time’s up ! Siti Amina range son oud dans son étui, attrape un large panier qu’elle jette sur son épaule et franchit sans traîner l’imposante porte sculptée du vieil édifice. Elle a rendez-vous avec la chanteuse Siân Pottok, qui joue aussi du kamele n’goni : les deux musiciennes travaillent actuellement à la création d’un répertoire original pour la prochaine édition du festival français Africolor.
Parce que l’union fait la force, à Zanzibar, d’autres sœurs n’attendent rien ni personne pour prendre leur destin en main, en créant notamment des ensembles de taarab exclusivement féminins. En 2020, la violoniste et compositrice Rahmah Ameyr réunit onze femmes pour fonder l’orchestre Uwaridi Female Band dans les pas des Tausi Women’s Taarab, seize musiciennes qui ont même eu l’honneur d’accompagner de son vivant Bi Kidude. Dans sa lignée, leur leadeuse Maryam Hamdani écrit des textes critiques qui dénoncent le puritanisme des imams et conduit le groupe, depuis sa formation en 2009, à se produire dans les villages isolés de l’archipel pour sensibiliser les jeunes filles aux luttes féministes. Chez les solistes, la chanteuse Siti Muharam réactive avec brio l’héritage pionnier de Siti Binti Saad, son arrière-grand-mère, allant jusqu’à remporter un Songlines Award en 2020 pour son premier album, Siti of Unguja (Romance Revolution On Zanzibar). Connue à Zanzibar comme « la DJ au hijab », Aisha Bakary explore enfin le potentiel de transe des grandes voix du taarab en remixant, depuis 2016, des classiques sur ses platines. Porté par une armée de guerrières, au cœur de l’identité zanzibarie, le taarab insulaire semble avoir de beaux jours devant lui.
Avant de quitter l’archipel s’impose un dernier crochet par la Dhow Countries Music Academy qui accueille, tout l’après-midi, un atelier de pratique vocale mené par la mezzo-soprano allemande Anne Buter. Appliqué, en cercle, le futur du taarab travaille autant qu’il peut et surtout tant qu’il le peut encore : désespérée, l’école vient de lancer une cagnotte en ligne afin de récolter des dons pour s’assurer un avenir, faute de soutien du gouvernement local comme de l’État tanzanien — dirigé par la zanzibarie Samia Suluhu Hassan, présidente depuis la mort de John Magufuli en 2021. « À Zanzibar comme dans le reste de l’Afrique, les politiciens se servent de nous chaque jour pour servir leurs intérêts, soigner leur image et animer leurs événements politiques, ils ne peuvent rien faire sans les artistes. Alors pourquoi n’investissent-ils pas plus dans la musique ? » demande Siti Amina, répondant sans s’interrompre à sa question rhétorique. « Moi je pense que ceux qui nous gouvernent connaissent le pouvoir de la musique et de l’art. Pour l’éveil des consciences, ce sont des armes très puissantes et ça, ça leur fait peur. Et puis, si le taarab est en danger, c’est aussi parce qu’au final, les touristes semblent y être plus attachés que les gens d’ici qui ne pensent, quitte à s’y perdre, qu’à copier le reste du monde. »

Face à la déferlante afrobeats et à une scène singeli si dynamique en Tanzanie qu’elle réunissait, début février, plusieurs milliers de personnes à Dar-es-Salaam pour l’ambitieuse convention internationale Singeli 2 The World, le lyrisme ancestral du taarab supportera-t-il la concurrence dans le cœur de la jeunesse zanzibarie ? Pour Thureiya, hakuna matata, tout ira bien. « À mon avis, ce n’est qu’une question de temps avant que les jeunes ne reviennent au taarab » prophétise l’apprentie chanteuse. « Certes, pour l’heure, les gens de ma génération préfèrent écouter Diamond Platnumz et peu d’entre eux savent qui est Siti Binti Saad. Mais les modes sont cycliques, même le pantalon baggy est de nouveau tendance ! Alors qui sait ? »
Oui, qui sait ? Peut-être que dans quelque temps, les mêmes qui écoutent aujourd’hui du singeli non stop s’apercevront qu’il sample le taarab et reviendront boucler la boucle à la source. Peut-être que la DCMA sera sauvée. Peut-être que le gouvernement local finira par déclarer que le taarab est aussi précieux que la tanzanite, même s’il rapporte moins. Peut-être même que Brain Boy ira aux Grammys et Siti Amina à l’ONU. Qui sait ? Time will tell… Pour l’instant, il est l’heure de partir et un dernier regard vers Stone Town attrape comme un oracle une phrase du coin de l’œil sur la façade du Freddie Mercury Museum. The show must go on !